Dernière publication :
mercredi 15 avril 2015
Rechercher
par mot-clé
par index

Story Leonard Cohen, Part Two
par Vyvy le 17 juin 2008




Un chanteur sachant chanter...
Quelque part dans un quartier branché de Montréal, en janvier de l’an de Grâce 1966, Leonard Cohen, entre autres poète de son état, fait une déclaration estomaquant l’assistance. « Je serais le Bob Dylan canadien ». Incompréhension, attendrissement (« Encore une autre frasque ? »), perplexité. Bob qui ? Car si Cohen s’enthousiasme pour les affres de Zimmerman, le Canada littéraire n’a alors pas encore succombé à son charme tordu, et imaginer Cohen, auteur reconnu, voire même connu, s’étant taillé une niche, à défaut d’être riche, espérer atteindre le niveau d’un moins que rien… Non, non, ça doit encore être une de ces bizarres idées de Cohen, après tout, n’est-il pas poète, et donc enclin à tout si ce n’est la raison ? Alertés par Layton quelques temps plus tard, lors d’un concert montréalais du barde de Duluth, les étudiants de Cohen gémissent d’effroi : « Mais, il ne sait pas chanter ! ».
Pourtant Cohen s’est fait une raison, sa passion pour la poésie, bien qu’elle vibre tout aussi fort qu’au jour de ses 15 ans, ne lui permet pas de vivre une vie décente. Le seul endroit où ceci était possible, la grecque Hydra, il le trouve désormais repoussant, son air libre entaché de miasmes libidineux. Et puis Hydra, c’est Marianne, auprès de laquelle il étouffe de plus en plus. Il lui faut changer de port, changer son fusil d’épaule. Lui, l’homme aux cinq accords, se voit musicien de session à Nashville. Il deviendra singer-songwriter, en marge du revival folk à New York….
Ainsi va Cohen, cherchant à approcher Dylan et son monde, au cœur de la Big Apple. Il se passe quelque chose à New York qui l’intrigue, mais, comme d’habitude, il ne s’y immergera pas longtemps, ni complètement. Trop jeune et bourgeois pour les Beatniks, il sera trop vieux et ascète pour les folkeux, mais ça il ne le sait pas encore, et avec en guise de jument jaune une guitare mal foutue, il monte à la grande ville, une lettre de recommandation en poche, et une fraiche envie de recommencer. Son M. de Tréville est une dame, canadienne et assistante d’Albert Grossman, manager entre autres de Dylan, Mary Martin. Les mousquetaires qui l’aideront dans sa tache ne sont pas vraiment au nombre de trois, tant Cohen butine à droite et à gauche, drogues, amitiés et amour.
Il y aura Judy Collins, star montante du folk, qui aimera ses chansons sans trouver, en premier lieu, quelque chose pour elle –car Cohen au départ se voit plus scribouilleur que performer. Il y aura le légendaire Stanley Bard, manager/propriétaire du Chelsea Hotel, où Cohen échoue rapidement, comme une bonne partie des scènes et folk et rock (j’ai nommé, pour allécher, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Joan Baez, Kris Kristofferson, Allen Ginsberg…). Il y aura Lou Reed et Nico. Au premier, lecteur assidu de ses œuvres, Cohen offrira son estime, et vice-versa, les deux artistes se complaisant dans les louanges admiratives de l’autre. A la seconde, Cohen de manière pas encore vraiment originale offrira son cœur, mais Nico, elle, préfère les hommes plus jeunes.

Pauvre Leonard. Ses débuts à New-York ne font pas mouche. Il en appelle à Marianne, qui quitte Hydra et vient le rejoindre avec son fils. La scène de leurs retrouvailles, Marianne chargée comme un baudet répondant à son lointain signe de la main par un splendide signe du pied, est un de ces rares souvenirs que Cohen garde en lui. L’homme n’est pas du genre à chercher à revivre une gloire passée ; qu’il avance ou qu’il stagne, il ne regarde que peu en arrière. Il loge Marianne et son fils dans un petit appartement, où il passe souvent, et découche tout autant. Pas à sa place, il se cherche, et la cherche. Le vent va tourner, et se vent s’appellera Suzanne.
Suzanne(s)
Suzanne takes you down, to her house by the river…
Voilà en somme ce qu’entend Judy Collins au téléphone, un soir d’automne 1966. Elle avait indiqué à Cohen de ne pas hésiter à la recontacter, s’il avait d’autres matériels. Et, Suzanne, muant lentement du poème à l’hymne, est un sacré matériel. Il incarne l’air du temps, et l’intemporel Montréal. La chanson, sûrement le plus grand succès de Leonard Cohen, est le fruit de sa rencontre avec Suzanne Verdal, épouse d’un de ses grands amis, le sculpteur Armand Vaillancourt. Sur Suzanne, beaucoup de choses ont été dites. Le côté « reportage » de la chose est appuyée par Cohen, il y avait en effet du thé à l’orange et une maison près du St Laurent. Le côté platonique est lui bien rappelé par l’intéressée, et si Cohen touche son « perfect body with [his] mind » c’est bien faute d’avoir pu toucher autre chose. Et le côté fantasmagorique, ode à sa ville et ses clochers, laissera songeur des armées de rêveurs.
 Judy Collins accepte de suite. Généreuse, elle s’entiche aussi de Dress Rehearsal Rags. Cohen perce enfin et ces deux titres sortent en novembre sur l’album In My Life de Judy. Son ange gardien ne va pas s’arrêter là, lui faisant/le forçant à faire sa première scène. Nous sommes le 30 avril 1967, et Collins à déjà enregistré son album suivant, sur lequel figurent trois nouveaux titres de Leonard. Le voilà enfin là où il veut, et il se plante. Sa guitare est mal accordée, et un trac immense l’envahi ; il essaie, bafouille et s’enfuit. Il faudra les encouragements de Judy et la liesse de l’assistance pour que Cohen, guitare accordée et déterminé, vienne finir son set. Il a survécu à ca, et tout va s’accélérer pour lui.
Judy Collins accepte de suite. Généreuse, elle s’entiche aussi de Dress Rehearsal Rags. Cohen perce enfin et ces deux titres sortent en novembre sur l’album In My Life de Judy. Son ange gardien ne va pas s’arrêter là, lui faisant/le forçant à faire sa première scène. Nous sommes le 30 avril 1967, et Collins à déjà enregistré son album suivant, sur lequel figurent trois nouveaux titres de Leonard. Le voilà enfin là où il veut, et il se plante. Sa guitare est mal accordée, et un trac immense l’envahi ; il essaie, bafouille et s’enfuit. Il faudra les encouragements de Judy et la liesse de l’assistance pour que Cohen, guitare accordée et déterminé, vienne finir son set. Il a survécu à ca, et tout va s’accélérer pour lui.
Mary Martin qui le manage plus ou moins fait venir John Hammond (découvreur de Dylan, Aretha Franklin and co) de Columbia dans la petite chambre de Cohen au Chelsea. Il lui joue son petit répertoire, et bingo, Hammond est enchanté, trouvant que Leonard a le truc en plus que les autres n’ont pas. Et voilà Leonard, signé chez Columbia - quand bien même hors Hammond, la grosse machine n’est pas trop emballée, et en route pour son premier album Songs of Leonard Cohen.
Jusqu’au premier jour d’enregistrement, Cohen n’avait jamais gracié un studio de son humble présence. Il se sent mal à l’aise, peu sûr de lui, il ne sait pas lire de musique. Alors Hammond, qui décide de le produire, l’accommode. Une lumière tamisée, une. Un miroir – Cohen, narcissique, ne jouait que devant des miroirs. Mais cela n’avance pas, si bien qu’Hammond, malade, se retire pour laisser la place à John Simon qui va un peu bouger Cohen. Des chœurs par-ci, une batterie par-là. On ajoute, on soustrait, la bataille est rude et constante, les deux hommes n’ayant pas la même vision de l’album. Au final, Songs of Leonard Cohen est un petit bijou, et ce malgré des arrangements ne jouant pas toujours en sa faveur. Cohen, qui se taillait jusqu’alors un petit nom de songwriter, s’offre au monde en tant que singer. Poète, chansonnier, chanteur, la palette s’élargit, et les finances suivent correctement. Le nom de Cohen se répand lorsque Judy Collins récidive et sort Wild Flowers dans lequel figure encore trois chansons du Canadien. L’album, sortant pendant les séances d’enregistrement de Cohen, prépare le chemin pour la sortie de celui de Cohen le 27 décembre 1967.
 Songs Of Leonard Cohen va surprendre. Son titre d’abord. Une manière de le comprendre est la volonté de Leonard de placer ce travail en continuation de ses travails précédents. A savoir, vous m’avez connu poète, regardez ce que ça donne quand je chante. Au vu de ses succès commerciaux limités, il n’est pas sûr que la stratégie publicitaire ait fait mouche, mais bon. La critique est indécise ; ainsi Buffy Sainte-Marie décrit son œuvre comme manquant de « racines et de direction » mais sachant se montrer enchanteresse.
Songs Of Leonard Cohen va surprendre. Son titre d’abord. Une manière de le comprendre est la volonté de Leonard de placer ce travail en continuation de ses travails précédents. A savoir, vous m’avez connu poète, regardez ce que ça donne quand je chante. Au vu de ses succès commerciaux limités, il n’est pas sûr que la stratégie publicitaire ait fait mouche, mais bon. La critique est indécise ; ainsi Buffy Sainte-Marie décrit son œuvre comme manquant de « racines et de direction » mais sachant se montrer enchanteresse.
Alors que Cohen se fait un petit nom, il se fait tout de suite de gros problèmes. Cohen n’a pas une tête pour le business, ni pour les chiffres. Lorsqu’il écrit un livre, jamais un contrat ne le lie à son éditeur, Cohen refusant d’en signer. Et, lorsque Mary Martin lui présente un arrangeur, Jeff Chase, qui pourrait apporter une touche intéressante à ses chansons, le voilà qui signe un document qu’il croit temporaire, donnant à Chase les droits sur Suzanne, Dress Rehearsal Rags, et Master Song. Jusqu’au milieu des années 80 cette erreur va ronger le sang et les finances du Canadien.
Pour l’heure, Cohen a la tête ailleurs. En parallèle de ces projets musicaux, Cohen à une année 1967 bien chargée. Il s’entiche de Joni Mitchell après l’avoir rencontrée au festival de Newport de la même année, et passe du temps avec elle en Californie. Leur relation redeviendra assez rapidement une amitié platonique, et les deux artistes se soutiendront mutuellement des années durant. C’est d’ailleurs lors d’un passage californien que Cohen rencontre et ignore pour la première fois la scientologie. Il y succombera pourtant peu après, assez longtemps pour comprendre son erreur et partir en courant. Passant de Joni à New-York, il joue de plus en plus de petites salles. C’est dans ce climat que Cohen sort son album. La piste Long Marianne annonce bien la couleur ; sa relation avec Marianne, on l’imagine affaiblie par sa relation avec Joni Mitchell qui continue en 1968, se rompt définitivement. L’oiseau Cohen s’envole, laissant une Marianne passablement enragée.
Le vent tourne, et il s’appellera Suzanne. Du haut de ses 19 ans, Suzanne Elrod, que Cohen rencontre au printemps 1968 sera, au même rang que Marianne, une ancre pour Cohen, une muse qui l’obsèdera pendant une dizaine d’années.
Suzanne est déjà entretenue par un homme d’affaire lorsqu’elle croise le chemin du poète. Suzanne n’était pas et ne serait jamais une deuxième Marianne, non ; là où la première s’évertuait à créer un cocon protecteur auprès du poète, la vie avec Suzanne sera beaucoup plus mouvementée, faite de rapports de force. La sombre brune partage avec Cohen sa religion, mais aussi une complexité de caractère, une intensité, qui fait penser à Cohen qu’il a, enfin, trouvé son égale. Elle va entrer dans la vie de Cohen en coup de vent et la changer radicalement.
Ils quittent rapidement New York, et errent. C’est la Grèce puis le Canada qui les accueillent ; ils écrivent, vont et viennent entre les continents, pour enfin arriver à la destination de départ de Leonard : Nashville, Tennesse.
Nashville ou la petite maison dans la prairie
Cohen semble alors confondre les lieux, et confondre les femmes. A moins que, où qu’il soit, avec qui qu’il soit, il n’essaie de reproduire son paradis perdu, Hydra des premiers jours. Il loue ainsi une petite ferme perdue, dans les environs de Nashville, avec cheval, fusil et voisin fou, et y vit de manière spartiate, assaisonné au régime macrobiotique qu’il suit pendant quelques années. Pendant que Suzanne s’essaie à la poterie et se fait de longues robes, Cohen écrit, puis enregistre son deuxième album, Songs From a Room.
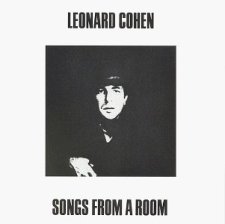 On pourrait se demander quelle mouche l’a piqué. Que fait un écrivain, ténébreux, tourmenté, juif de surcroit, et citadin, dans un trou paumé de la Bible Belt, où la musique est country et les arrangements tape-à-l’œil ? Ce serait pourtant mal connaître et Cohen et son temps que de trouver cela extravaguant. L’heure est au mélange des genres, et Dylan le premier est allé enregistrer à Nashville. Et puis, si Cohen y va, c’est que depuis ces débuts musicaux dans les Bucksin Boys, il a gardé un petit amour pour cette musique. Enfin, il ne vient pas ici enregistrer avec n’importe qui, mais avec Bob Johnston, qui sort de la production du mythique Blonde on Blonde dylanien.
On pourrait se demander quelle mouche l’a piqué. Que fait un écrivain, ténébreux, tourmenté, juif de surcroit, et citadin, dans un trou paumé de la Bible Belt, où la musique est country et les arrangements tape-à-l’œil ? Ce serait pourtant mal connaître et Cohen et son temps que de trouver cela extravaguant. L’heure est au mélange des genres, et Dylan le premier est allé enregistrer à Nashville. Et puis, si Cohen y va, c’est que depuis ces débuts musicaux dans les Bucksin Boys, il a gardé un petit amour pour cette musique. Enfin, il ne vient pas ici enregistrer avec n’importe qui, mais avec Bob Johnston, qui sort de la production du mythique Blonde on Blonde dylanien.
C’est ainsi que Cohen reprend le chemin du studio, entouré par des musiciens rompus à cet exercice, et que Johnson met à l’écoute de Cohen. Loin des affrontements et brusqueries de John Simon, Johnson rassure et crée un cocon autour de Cohen. Les arrangements sont discrets, la voix de Cohen sonnant presque nue ; sans batterie, et avec quelques légères touches de guitares électriques. Songs From A Room, plus que le précédent, caractérise le son que Cohen apporte au Folk, d’une nudité, dans le son et les paroles, qui s’accompagne d’une profondeur et d’un sérieux qui donneront du fuel aux critiques taxant l’œuvre de Cohen de dépressive et d’invitation à en finir.
L’album regorge de chants qui aujourd’hui encore sont dans les plus grands succès de Cohen. Il y a en ouverture Bird on the Wire, mais aussi The Partisan, pour laquelle Cohen va enregistrer des voix féminines dans l’Hexagone. L’album est un "grand" succès, marchant bien en Angleterre, mais surtout explosant en France où le Nouvel Observateur nomme Cohen folksinger de l’année 1969… Bientôt, Georges Pompidou déclarera emporter ses disques en vacances…
Fort de ce succès, Cohen s’amuse à regarder ailleurs. Il fait la B.O. d’un film de Robert Altman, McCabe and Mrs. Miller, et celui-ci se fait lapider par la critique. Altman plus tard le considèrera comme son pire film, un amer réveil après le succès de M.A.S.H..
On the Road Again
L’année 1969 va apporter de nombreux changements dans la vie de Leonard. Il découvre le Zen, sort un recueil de poèmes et entame sa première tournée.
Ces années folles des sixties amènent en Occident une envie de changement, qui se traduit aussi sur le plan spirituel. L’Inde attire ; et les gourous viennent en Europe, et les occidentaux viennent aux gourous, prenant la route de l’Orient, mélange de drogues et de spiritualité. Aux Etats-Unis, l’orientalisme est en vogue ; les sectes aussi : tout le monde se cherche, et se cherche un Dieu adéquat. Cohen, au beau milieu de ce beau monde qui se converti et s’envoie en l’air à tout va, suit un temps le mouvement, se laissant, on l’a vu, tenter un temps par la scientologie. Mais lorsqu’au travers d’un copain d’Hydra, Steve Stanfield, il rencontre le Zen en la personne du missionnaire japonais Joshu Sasaki Roshi, il trouve chaussure à son pied bien loin des rêves hippies.
Roshi s’est installé en 1962 près de Los Angeles pour enseigner une version dure et stricte, presque militaire du Zen, le Rinzai. L’exercice est dur, les nuits sont courtes, les demandes sur les élèves, vivant de manière spartiate, pourraient en dégouter plus d’un. Leonard découvre un monde qui l’attire, comme l’armée, l’ordre, la solitude et la simplicité l’ont toujours attiré. A l’époque la rencontre n’est que furtive, mais Cohen s’est trouvé un point de chute.
C’est pourtant loin de Los Angeles, à Ottawa, que Cohen va commencer à créer la polémique en cette année que l’on dit érotique. Québécois de langue anglaise, il est doublement déchiré par ce qui se passe au Québec, les aspirations d’indépendance ne le laissant pas de marbre. Ainsi, lorsqu’il reçoit le Governor General’s Award for Poetry pour son Selected Poems, 1956-1968, il dit non.
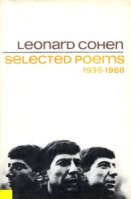
Non au plus grand titre littéraire canadien et à son généreux chèque ; Cohen, qui avait tant rêvé de ce prix pour Spice Box of Earth surprend et fait enrager une bonne partie de ses amis canadiens, qui se demandent vraiment quelle mouche à bien pu le piquer, encore plus quand celui-ci vient squatter la fête donnée par son éditeur en l’honneur du prix. Décidemment, devenir chanteur lui a fait perdre la raison, s’émeut-on. Le recueil qui a failli être primé est une sorte de best-of, une compilation de poèmes, commencés avec l’aide de Marianne, dont certains ont déjà été publiés et beaucoup sont inédits. De fait, au vu des faibles tirages et ventes des opus précédents, ils sont un nouveau matériel pour la grande majorité des lecteurs. Et c’est fort de son nom de chanteur qu’il sort pour la première fois sa poésie aux U.S., utilisant une méthode de marketing inverse de celle de Songs Of Leonard Cohen : désormais, c’est Cohen chanteur qui conduira au Cohen écrivain, et ce jusqu’à nos jours.
On l’a suggéré plus haut, Songs From A Room est un « succès », et il donne des ailes à notre Canadien, qui de toute façon sent qu’il lui vaut mieux allez voir hors de chez lui pour un temps, le temps que la controverse se calme un peu. Cohen s’envole ainsi vers l’Europe et sa première tournée, avec un groupe compilé par Bob Johnston que Cohen incite à joindre derrière son clavier. Ce dernier n’était pas au début très chaud, mais, quand Cohen lui a forcé un peu la main ("Tu viens, ou je ne pars pas !"), il s’est fait une raison et a pris sa valise. Résultat ? "I just played piano and guitar and organ, whatever. I couldn’t play very well, but he couldn’t sing very well." ("J’ai joué du piano, de la guitare, de l’orgue, tout ça. Je ne jouais pas très bien, mais il ne chantait pas très bien...") [1]
Cohen se sent libre, et en ces temps, quand on se sent libre, on fait le con. C’est ainsi à coup de Sieg Heil ! qu’il salue Berlin, avant d’inviter tout Copenhague à le suivre à son hôtel, et le beau monde parisien à envahir la scène, car c’est plus cosy. Le clou du spectacle en Europe continentale est la prestation à Aix en Provence. D’affreux bouchons font craindre à Cohen qu’ils arriveront tard, si bien que de une de deux, ils empruntent des chevaux et cavalent jusqu’à la salle, jusqu’à sur la scène. Effet garanti, qui hérisse un peu l’audience, remplie, Ira Nadel l’affirme, d’affreux gauchistes rebutant à payer. Ca gueule de toute part, Cohen lâchant qu’aux armes ils répondront par les armes, coup de bluff calmant les choses, et nommant de facto son groupe The Army. Le tour 1969 se finira notamment par une prestation vers 4h du mat’, en pyjama puis costume presque impeccable, au festival de l’Ile de Wight. Le public est exténué, Jimi Hendrix vient de sortir de scène. Cohen s’avance et les berce, s’immisçant tranquillement dans leurs bonnes grâces.
L’Europe aime Cohen et Cohen aime l’Europe. Lui et son groupe profitent amplement des revenus de la tournée, lorsqu’à chaque fois qu’ils arrivent dans une nouvelle ville, Cohen les invites pour un beau gueuleton dans le meilleur resto de la ville... Cette tournée où Cohen s’est tant ouvert va amener un sacré retour de bâton quand il retrouvera enfin le chemin de Nashville. Cohen commence alors à vivre à la hauteur de sa réputation, et sombre dans une profonde dépression.
Love and Hate
 Sa relation avec Suzanne commence à vaciller. Elle n’a plus grande confiance en son art, et il n’est plus autant fasciné par sa beauté ; ca va, ca vient, mais en attendant, ca fait mal. Cohen doute, de tout. Surtout de lui, de sa voix, de ses cinq accords. Ces doutes s’expriment plus d’ailleurs en dehors que dans le studio. Car Bob Johnston veille au grain et au Canadien, si bien que l’enregistrement du troisième opus de Leonard se passe plutôt bien. D’où viennent ces chansons d’amour et de haine ? Ce sont, comme souvent chez Cohen, de vieilles chansons, remaniées au fil des âges. Côté haine, ou face 1 du vinyl originel, Dress Rehearsal Rags, offert à Collins dès 1966 y est enfin enregistrée. La chanson, sûrement une des plus déprimantes de Cohen (quoiqu’il faut l’avouer, la compétition est rude, même sur cet album), parle suicide. Cohen aura quelques années plus tards ces mots révélateurs : "I’m too old to die that kind of spectacular death. For me to commit suicide or O.D. would be...... unbecoming ..." ("Je suis trop vieux pour ce genre de mort spectaculaire. Commettre un suicide, ou faire une overdose, serait….déplacé."). On y trouve aussi Diamonds in the Mine, sautillante et pourtant bien déprimée, qui s’émeut que
Sa relation avec Suzanne commence à vaciller. Elle n’a plus grande confiance en son art, et il n’est plus autant fasciné par sa beauté ; ca va, ca vient, mais en attendant, ca fait mal. Cohen doute, de tout. Surtout de lui, de sa voix, de ses cinq accords. Ces doutes s’expriment plus d’ailleurs en dehors que dans le studio. Car Bob Johnston veille au grain et au Canadien, si bien que l’enregistrement du troisième opus de Leonard se passe plutôt bien. D’où viennent ces chansons d’amour et de haine ? Ce sont, comme souvent chez Cohen, de vieilles chansons, remaniées au fil des âges. Côté haine, ou face 1 du vinyl originel, Dress Rehearsal Rags, offert à Collins dès 1966 y est enfin enregistrée. La chanson, sûrement une des plus déprimantes de Cohen (quoiqu’il faut l’avouer, la compétition est rude, même sur cet album), parle suicide. Cohen aura quelques années plus tards ces mots révélateurs : "I’m too old to die that kind of spectacular death. For me to commit suicide or O.D. would be...... unbecoming ..." ("Je suis trop vieux pour ce genre de mort spectaculaire. Commettre un suicide, ou faire une overdose, serait….déplacé."). On y trouve aussi Diamonds in the Mine, sautillante et pourtant bien déprimée, qui s’émeut que
And there are no letters in the mailbox,And there are no grapes upon the vine,And there are no chocolates in the boxes anymore,And there are no diamonds in the mine.
Ces letters qu’il attend, sont celles de Suzanne qui retourne souvent à Miami ou New York - mais la belle écrit peu, le poète devenant de plus en plus enragé. Côté amour donc, Joan Of Arc, puis Famous Blue Raincoat donne à ce noble sentiment le mordant du feu et du ménage à trois. L’album est excellent, et si Cohen doute plus que jamais de sa voix, elle est à un de ses sommets. Mais il ne se vend pas très bien, ne devenant même pas or au Canada. Pourtant, du fin fond d’un sombre bled de Victoria, Australie, c’est au travers de ce disque que Nick Cave découvrira bientôt Leonard Cohen, une rencontre tournant pour lui, qui fera de lui un amateur prosélyte du Canadien.
Mais ça, Leonard ne le sait pas, et puis on peut bien imaginer, que s’il l’avait su, il n’en aurait rien eu à faire, tant la dépression m’sieurs-dames, ca vous occupe un homme. Que fait-on quand on va mal et qu’on s’appelle Leonard Cohen ? On bouge. Ils déménagent alors de nouveau à Montréal, où Cohen s’installe dans un quartier d’émigrés, loin des collines de son enfance, au début de l’année 1972. Cohen pense à une autre tournée, et s’y prépare ardemment… en redescendant à Nashville.
C’est au cours de la préparation de cette tournée dans le Tennessee que Cohen va faire une rencontre musicale cruciale : Jennifer Warnes, qui va devenir la voix derrière la voix de Cohen, sa choriste la plus célèbre, et une artiste solo reconnue. Cohen a toujours besoin de se préparer ardemment aux tournées, ayant une sacré tendance, qui s’amplifiera avec l’âge, à oublier ses chansons. Mais pour notre Canadien, la préparation d’une tournée, lui que la scène attire et effraie tant, ne peux être que musicale, et c’est ainsi qu’il décide de soigner sa dépression/préparer sa tournée à coup de jeûne, séance de yoga et méditation.
Le voilà prêt. Il laisse Suzanne enceinte à Montréal, et part (re)conquérir l’Europe, avec the Army et ses nouvelles choristes. Comme pour la tournée précédente, Cohen et son équipe vont faire forte impression. Une citation de Goebbels en introduction à Francfort, des instruments coincés à la douane à Vienne, si bien qu’ils jouèrent ce soir-là sur les instruments du public… Mais cette tournée est surtout marquante pour trois choses : l’ouverture à Dublin un soir de Saint Patrick dans le Guinness Auditorium, le reportage, Bird on The Wire, un peu précieux, sur Cohen et son passage britannique, et le final à Jérusalem.

A Jerusalem, Cohen craque, s’effondre en pleurs, courant hors de scène, demandant qu’on rembourse le public. Jouer dans cette ville, si spéciale pour lui, après une tournée éreintante, pour lui qui est au plus profond d’une dépression, c’est trop… Ses musiciens viennent alors le voir, s’enquérant de son état. Cohen est crevé, il veut se raser et oublier ce soir. Mais… fouillant son sac à la recherche de son rasoir, Cohen trouve à la place un peu de LSD qui traînait là depuis quelques années. De une, de deux, ils en prennent tous et remontent sur scène, lorsque le public se met à entonner Zim Shalom. Le concert, coupé au milieu, repris sous acide, reste une des prestations les plus bizarres de Cohen, mais va le pousser à très bientôt revenir en Israël.
De la promotion de Songs of Love and Hate puis de la tournée suivante, il reste quelques interviews, notamment celles données par Cohen à Billy Walker, du magasine britannique Sounds. De ces deux interviews, de 1971 et 1972, on peut retenir quelques morceaux, leitmotiv de Cohen. Son rapport au travail, lui qui se lève chaque matin pour exercer son métier de songwriter ou de writer tout court. Ses chansons ne lui viennent pas facilement, et chaque chanson, à l’exception de Sisters Of Mercy qui lui vint en une nuit, sont le fruit de plusieurs mois ou années de travail, de mâchage, de ratures, pour enfin déboucher sur une version, si ce n’est finale, au moins qu’il sent sonner bien, et digne de lui. Cohen travaille lentement, et il travaille seul, se nourrissant, se guérissant par le travail en solitaire. Alors il n’est évidemment pas du genre à pondre un album tout les six mois - ce qui est la norme à l’époque pour grand nombre d’artistes. Cela le range à part, cela permit aussi qu’on l’oubliât un peu. Intransigeant, il ne publie pas si ce n’est pas bon, il ne chante pas si ce n’est pas bon, et ne se considérant pas bon, ne s’aventure pas dans le chant des reprises, ne s’en sentant pas capable : « I feel if I sing my own songs nobody can complain » (« J’ai le sentiment que, si je chante (seulement) mes propres chansons, personne ne peut se plaindre »). Son rapport à la richesse, à ce qui est « dans le vent » en cette époque, est aussi décortiqué. Cohen est à part, là aussi, lui qui préfère les hôtels bas de gamme aux palaces, et qui joue gratuitement dans des hôpitaux psychiatriques. Il ne se sent pas à l’aise dans une société qui valorise plus les artistes que ceux qui font vraiment quelque chose, ouvriers, paysans. Cohen est devenu célèbre trop tard, dit-il, après trop d’années spartiates, pour pouvoir embrasser un style de vie plus faste.
Tout laisser tomber ?
Cohen est encore à Londres quand Suzanne donne naissance à leur fils, Adam Cohen, en septembre 1972. Les relations entre Leonard et Suzanne ne s’améliorent pas vraiment. Soufflant tous deux le chaud et le froid, le couple se disloque pour mieux se retrouver. En phase de dislocation, Cohen s’enfuit le Zen et Roshi. La discipline qui règne sur le Mont Baldy près de Los Angeles, pourtant, n’est pas encore pour lui. Après quelques semaines d’exercices intensifs, Cohen prend la poudre d’escampette, et soufflant le chaud, invite Suzanne à le rejoindre a A Capulco. C’est là que sera prise cette photo de Cohen, aux cheveux presque ras –séquelle de son passage Zen- qui fera l’arrière de couverture de The Energy of Slaves ainsi que la pochette de Live Songs, projet dans lequel il va se laisser entrainer.

The Energy of Slaves, son nouveau recueil de poésie, reste comme une de ses œuvres les plus abouties, et une de celles qu’il préfère. L’heure n’est pas à la rigolade, et le livre est d’un sombre encore inégalé chez Cohen. Le dégoût - de soi, du sexe, de la vie, en est le fil rouge. Dans ce recueil, Cohen développe un thème qui lui est cher : l’art, l’imagination sont au service de la recherche de la beauté, de l’amour, mais une fois cette beauté atteinte, l’art se meurt et l’imagination tarie. Ce va et vient incessant entre amour et art, couple et solitude, illustre bien la vie du Canadien.
Mais sa vie, elle ne lui convient pas, ou alors plus. 1973 le voit retourner à Londres, pour régler cette sombre affaire de Bird on the Wire, ce film sur sa tournée précédente, qu’il ne voulait pas, mais qu’il a payé. Le résultat ne lui convient pas, il passe ainsi plusieurs mois à Londres, travaillant sur le matériel, recoupant, pour que le film qui en ressorte –toujours très personnel, trop pour lui- lui convienne un peu plus. CBS, sa compagnie de disque, est là, proche de lui, mère un peu trop poule, et il se sent étouffer.
Cohen veut tout laisser tomber ? Ce n’est pas vraiment ce que Cohen veut dire, mais c’est ce qui se dit, et se publie, après son interview avec Roy Hollignworth du Melody Maker. Cette interview, discussion à bâtons rompus sur l’état – que les deux interlocuteurs jugent pitoyables - du Music Business de l’époque, voit Cohen dire beaucoup de choses. Que maintenant que les choses musicalement marchent (Songs of Leonard Cohen vient de devenir disque d’or aux Royaume-Uni, cinq ans après sa sortie…) on –c’est-à-dire CBS - cherche à l’exploiter. Qu’il n’écrit plus, ne veux plus écrire tout de suite. Qu’il a envie d’autre chose, bien qu’il soit en train de fignoler son disque live, Live Songs. Bref, qu’il en a marre de cette vie, centrée sur la musique, et que si les chansons veulent venir, elles viendront, mais que jamais il ne se forcera à cracher du texte, pour faire plaisir à la maison de disque, aux distributeurs, aux impatients. Qu’à force de s’être immergé dans cet univers rock, cet univers musical, ce marché de la musique, il s’est coupé de la vraie vie, de là ou il tire ses chansons. Asséché, il doit repartir. Cohen s’en défend, mais de la à penser qu’il envisage de se retirer complètement de la musique, il n’y a qu’un pas, que franchit le Melody Maker, créant un buzz adéquat, et mettant pas mal de monde dans l’embarras.
 Cohen publie donc Live Songs, sous des rumeurs que ce sera son dernier album. L’ouvrage présente des chansons enregistrées pendant la tournée précédente, et offre un recueil de chansons et d’états d’âmes passionnant. Commercialement, c’est un flop. Musicalement, c’est un petit moment de bonheur, où on entend enfin les chansons sortir des carcans sobres des albums pour prendre une vie propre. Please, Don’t Pass Me By plus que toutes les autres -bonnes- chansons de cet album, fait miroir aux tourments de l’artiste. On y retrouve la Seconde Guerre Mondiale ("Well I sing this for the Jews and the Gypsies and the smoke that they made."), la haine et le dégout de soi et la salvation par la réformation personnelle :( "Ah, I’m not going to be. I can’t stand him. I can’t stand who I am. That’s why I’ve got to get down on my knees. Because I can’t make it by myself. I’m not by myself anymore because the man I was before he was a tyrant, he was a slave, he was in chains, he was broken").
Cohen publie donc Live Songs, sous des rumeurs que ce sera son dernier album. L’ouvrage présente des chansons enregistrées pendant la tournée précédente, et offre un recueil de chansons et d’états d’âmes passionnant. Commercialement, c’est un flop. Musicalement, c’est un petit moment de bonheur, où on entend enfin les chansons sortir des carcans sobres des albums pour prendre une vie propre. Please, Don’t Pass Me By plus que toutes les autres -bonnes- chansons de cet album, fait miroir aux tourments de l’artiste. On y retrouve la Seconde Guerre Mondiale ("Well I sing this for the Jews and the Gypsies and the smoke that they made."), la haine et le dégout de soi et la salvation par la réformation personnelle :( "Ah, I’m not going to be. I can’t stand him. I can’t stand who I am. That’s why I’ve got to get down on my knees. Because I can’t make it by myself. I’m not by myself anymore because the man I was before he was a tyrant, he was a slave, he was in chains, he was broken").
Suzanne, Adam et Leonard reprennent la route, en août, après une année bien difficile, où les choses n’ont pas financièrement souri à Cohen. Mais Cohen sait où aller à marée basse financière, et ils prennent la route d’Hydra, où ils s’installent de nouveau pour quelques mois. Cohen espère y retrouver une certaine paix, dans son esprit et dans son ménage, mais il n’y arrive pas, et s’ennuie tel un lion en cage, grognant un peu trop pour améliorer ses relations avec Suzanne. Et voilà qu’une occasion en or de « se remettre de la vanité d’une vie de chanteur », et accessoirement de fuir encore une fois une relation qui végète. La guerre s’apprête à gronder en Israël, et Cohen veut en être. Il s’envole en octobre pour l’état hébreu, arrivant quelques jours avant Yom Kippour et la guerre du même nom.
Mue sous le soleil
Un petit air de déjà vu serait le plus approprié. Après Cuba en pleine révolution, Israël en guerre ? Ben voyons… Sauf que cette fois-ci, au lieu de venir après, de constater, et de s’amuser (même si le jeu était dangereux) Cohen est là, quand ça se passe, et veut aider. Mais Cohen est Cohen. Et donc, avant de prendre la ligne du front, où il rejoindra d’autres artistes pour aller soutenir les soldats, il profite de ce temps hors de l’orbite de Suzanne pour faire plein de rencontres. Et, si l’envie d’écrire se tarit, l’envie de femmes, elle, reste toujours aussi grande, et les Israéliennes ne sont pas insensibles à son charme, même si le pauvre Canadien ne parle pas Hébreu du tout. Mais les rejoindre, il le fera, et son expérience sur le front en pleine guerre du Kipour lui inspirera Field Commander Cohen. Les artistes s’avancent, juste derrière la ligne de front, et chantent dès qu’ils tombent sur un groupe ami. Il retrouve l’envie de chanter, quand bien même sa plume est endormie. Cohen est alors obsédé par l’idée de se laver de ses péchés et de sa luxure. Il lui faut choisir entre luxure et écriture, entre luxure et prêtrise.
Après un mois passé en Israël, Cohen est prêt à partir, mais pas à rentrer. Il échoue donc en Ethiopie, où il restera un bout de temps, avant que ce pays aussi ne s’embrase. Dans l’ambiance surréaliste du Imperial Hotel, il finit enfin Chelsea Hotel #2 dont Jennifer Warnes se rappelle qu’il l’avait commencé en 1971, pendant la tournée de Songs of Love and Hate. Il commence d’autres chansons, notamment Field Commander Cohen. Musicalement, Cohen remonte la pente. Il retourne alors à Hydra, espérant que cet état d’esprit pénétrera aussi son foyer.
Ce n’est pas le cas. Et après avoir essayé en Grèce, ils ressaient à Montréal, où ils rentrent pour la naissance de leur fille, Lorca, nommée en l’honneur du poète à travers qui Cohen s’est ouvert à la poésie. Ils ne s’aiment plus, en tout cas Cohen ne l’aime plus, et Suzanne lui en veut ; elle qui avait 19 ans quand ils se sont mis ensemble l’accuse de l’avoir fait gâcher sa jeunesse.
 Sans que rien ne soit réglé émotionnellement parlant, Leonard Cohen reprend les chemins, et de la table d’écrivain, et du studio. Il planche sur des poèmes qui se retrouveront dans son futur recueil, et sur un album, New Skin for the Old Ceremony. Cohen est sorti du « music business » et de ses demandes, il a rétabli qu’il écrit comme il veut, quand il peut, mais qu’il écrit, lentement certes, mais assez pour revenir en studio. Sur New Skin... on retrouvera ainsi, enfin, Chelsea Hotel #2, mais aussi Take this Longing ou l’envoûtant If This Be Your Will. Cohen se plonge dans le Zen, passant de plus en plus de temps dans ce monastère du Mont Baldy auprès de Roshi. Il devient même par moments son secrétaire particulier, accompagnant son maître lorsque celui-ci rend visite à des moines trappistes pour les éveiller à la méditation…. Si bien que quand il revient en studio, c’est avec les conseils de Roshi qu’il se met au travail, lui qui lui dit de « chanter plus triste ».
Sans que rien ne soit réglé émotionnellement parlant, Leonard Cohen reprend les chemins, et de la table d’écrivain, et du studio. Il planche sur des poèmes qui se retrouveront dans son futur recueil, et sur un album, New Skin for the Old Ceremony. Cohen est sorti du « music business » et de ses demandes, il a rétabli qu’il écrit comme il veut, quand il peut, mais qu’il écrit, lentement certes, mais assez pour revenir en studio. Sur New Skin... on retrouvera ainsi, enfin, Chelsea Hotel #2, mais aussi Take this Longing ou l’envoûtant If This Be Your Will. Cohen se plonge dans le Zen, passant de plus en plus de temps dans ce monastère du Mont Baldy auprès de Roshi. Il devient même par moments son secrétaire particulier, accompagnant son maître lorsque celui-ci rend visite à des moines trappistes pour les éveiller à la méditation…. Si bien que quand il revient en studio, c’est avec les conseils de Roshi qu’il se met au travail, lui qui lui dit de « chanter plus triste ».
L’album est (co)produit par John Lissauer et sonne bien plus poli que le précédent, déjà vieux de trois ans, Songs Of Love and Hate. Lissauer rajoute aux chants de Cohen des cordes, notamment de la viole. L’écrin de la production, contrairement à Songs of Leonard Cohen ne joue pas trop contre les chansons, quand bien même Rolling Stonesqualifie les arrangements d’ "insensibles, mélodramatiques et envahissants". Mais ce n’est pas la production qui fera grincer les dents du label de Cohen, avec qui décidemment il n’entretient pas de bons (si ce n’est pas du tout de) rapports, mais bien la pochette aux deux anges affairés, qui paraîtra choquante pour le public US.
Cohen réussit à imposer son choix, et décide de reprendre la route, cette fois-ci avec son groupe. Et cette fois ci, ils ne traverseront pas l’océan, mais feront une tournée aux Etats-Unis.
[1] First We Take Berlin
Bob Johnston’s two world tours with Leonard Cohen, Louis Black, Austin Chronicle

























Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
